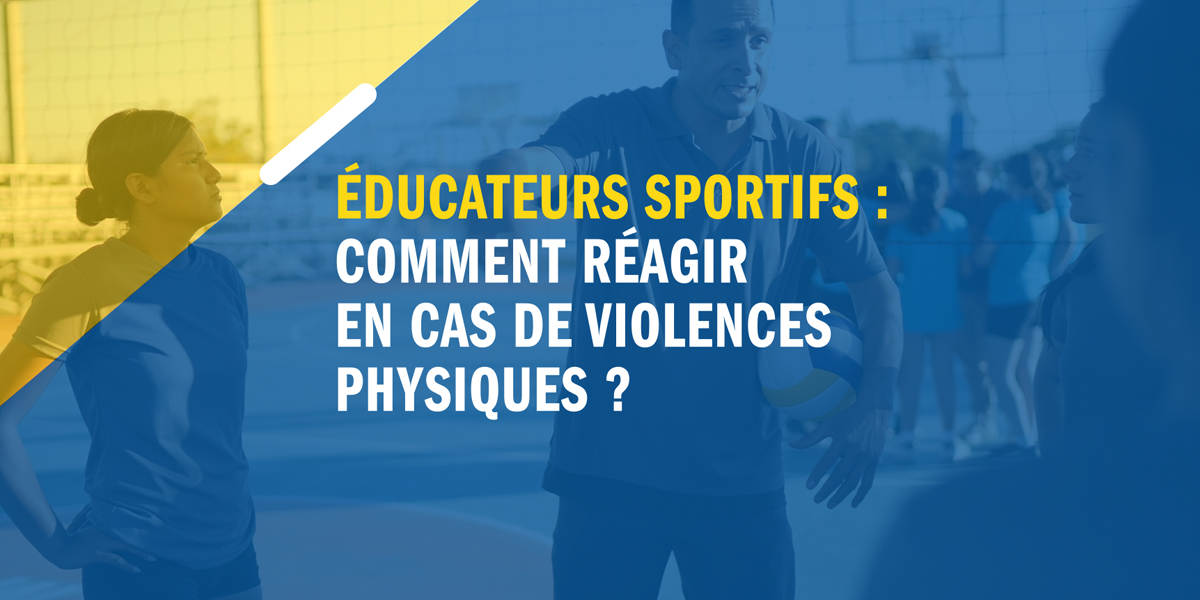Si les violences à l’école sont un phénomène aussi vieux que l’institution, elles ont été remises en lumière ces dernières années par des faits à la fois graves et médiatisés. Les agressions à l’encontre d’enseignants sont-elles de plus en plus …
[Insultes, menaces]