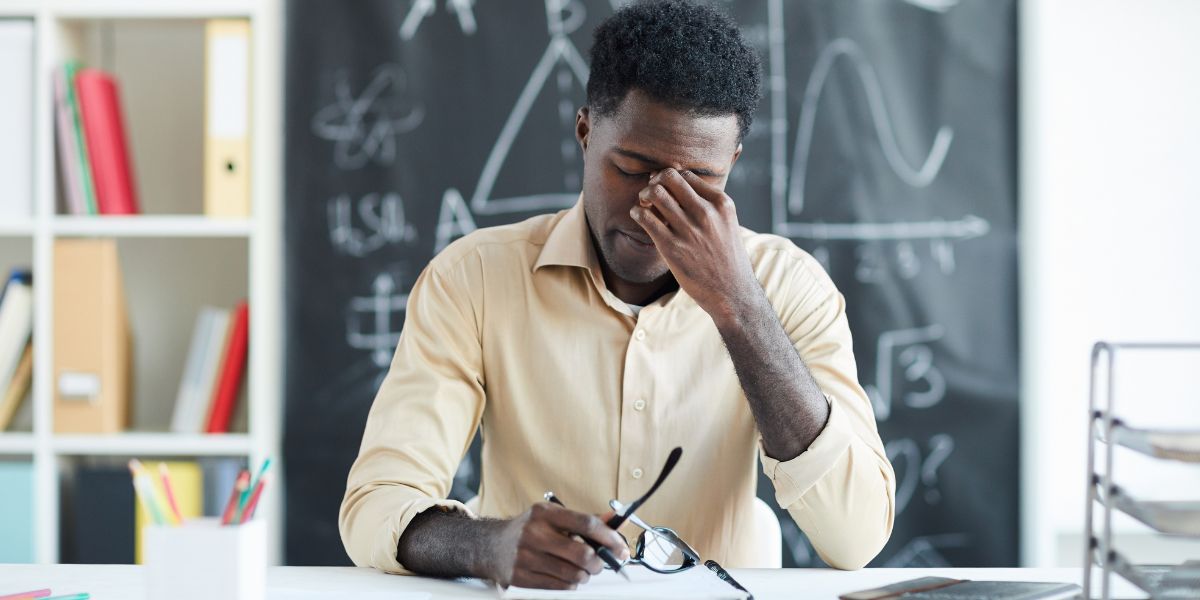Un mal-être et des risques psychosociaux qui s'intensifient
"Dans les collèges et lycées, seulement 31 % des personnels se disaient insatisfaits de leur métier en 2013, quand ils sont 55 % aujourd'hui."
Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale,
l’indice de satisfaction professionnelle s’élève aujourd’hui à seulement 6 sur 101 (contre 7,2 pour l’ensemble des Français en emploi). Les résultats de récentes études de L’ASL sur le climat scolaire, dans l
e 1er degré et
le 2nd degré2, vont dans le même sens et soulignent la dégradation considérable de la situation depuis 10 ans.
Dans les collèges et lycées, « seulement » 31 % des personnels se disaient insatisfaits de leur métier en 2013, quand ils sont 55 % aujourd’hui. À la question « Songez-vous à changer de métier ? », ils sont désormais non plus 30, mais 51 % à répondre « oui ».
Ce désamour n’est pas propre à la France, mais il y est particulièrement prononcé, comme le montre le Baromètre international de la santé et du bien-être du personnel de l’éducation 2023
3. L’Hexagone est ainsi le 2
e pays, parmi les 11 enquêtés, où les personnels éprouvent le plus souvent des sentiments négatifs tels que l’anxiété, la dépression ou le désespoir… Même constat en ce qui concerne le stress ressenti par la communauté éducative. La France est même lanterne rouge du classement sur l’équilibre professionnel/personnel, les possibilités d’évolution, ou encore la reconnaissance des métiers de l’éducation :
96 % des répondants estiment que leur profession n’est « pas » ou « pas du tout » valorisée dans la société.
De fait, le métier d’enseignant a considérablement perdu en attractivité et subit une crise de recrutement profonde, comme en témoignent à nouveau les milliers de postes non pourvus
4, 5 à l’issue des concours de recrutement en 2023.
Autre baisse tout aussi inquiétante, celle du nombre de médecins du travail dans l’Éducation nationale. Leur effectif est ainsi descendu à 77 aujourd’hui
6, ce qui est très insuffisant pour veiller sur 1,2 million d’agents
7 et assurer la visite (théoriquement obligatoire) qui devrait avoir lieu tous les 5 ans. Il y a là un vrai facteur de risque pour la santé des personnels.
F3SCT, ISST et RSST comme principaux cadres institutionnels pour protéger la santé au travail des personnels d'éducation
« Les registres de santé et de sécurité au travail (RSST) [...] dont doit obligatoirement disposer chaque établissement [...] permettent notamment à tout personnel de signaler une situation qu’il considère comme anormale ou susceptible de porter atteinte à sa santé. »
Des cadres existent pourtant au niveau institutionnel, à commencer par la
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT)8, instance liée au comité social d’administration (CSA), et qui succède au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La F3SCT se décline
au niveau national, académique et départemental, et a notamment pour mission de
contribuer à la protection de la santé physique et mentale des personnels. Il s’agit d’un organe de dialogue social, qui réunit à la fois des représentants de l’administration et du personnel.
Ces derniers ont notamment pour obligation de visiter chaque année au moins 3 lieux différents dans leur zone géographique, afin de pouvoir y juger ensemble des conditions de travail. À l’issue de ces visites, ils décident de mettre en place des actions de prévention nécessaires dans les établissements visités et dans ceux présentant des similarités. Sur ce périmètre, leur rôle se rapproche de celui des Inspecteurs en santé et sécurité du travail (ISST), qui contrôlent l’application des règles et proposent le cas échéant des mesures d’amélioration.
Les représentants du personnel des F3SCT et les ISST sont parfois également les destinataires des signalements que peuvent effectuer les personnels dans les registres de santé et de sécurité au travail (RSST)9.Ces registres, dont doit obligatoirement disposer chaque établissement (sous forme physique ou dématérialisée), permettent notamment à tout personnel de signaler une situation qu’il considère comme anormale ou susceptible de porter atteinte à sa santé. Ils sont en cela des outils d’alerte, destinés en première intention aux chefs d’établissement.
Interlocuteurs de proximité et dispositifs d’écoute
« Les chefs d’établissement sont des interlocuteurs clés, pouvant prendre des mesures immédiates, par exemple en cas de danger grave et imminent. Ils sont également épaulés par les assistants et conseillers de prévention, spécialisés sur ces questions de risques professionnels. »
C’est souvent en proximité que les personnels d’éducation peuvent trouver des solutions, en particulier lorsqu’il s’agit de situations critiques ou urgentes
10. À ce titre,
les chefs d’établissement sont des interlocuteurs clés, pouvant prendre des mesures immédiates, par exemple en cas de danger grave et imminent.
Ils sont également épaulés par
les assistants et conseillers de prévention, spécialisés sur ces questions de risques professionnels, qui interviennent notamment au niveau psychologique. Selon les académies, les agents peuvent également se tourner vers
le service social des personnels ou le pôle ressources humaines, qui peuvent leur proposer un accompagnement psycho-professionnel.
Au niveau national, enfin, il existe
une cellule d’écoute accessible gratuitement, 24h/24 et 7j/7. Constituée d’une équipe de psychologues, celle-ci est joignable au
0 805 500 005 et destinée à l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale. Mise en place dans le cadre d’un partenariat avec la MGEN, l’écoute y est individuelle et anonyme. C’est également le cas du numéro national de
prévention du suicide, le 31 14. Figurant désormais dans tous les carnets de correspondance des élèves de collège et lycée, ce numéro peut aussi être utilisé par les agents
11 qui en ressentent le besoin.
Le rôle déterminant des acteurs sociaux
« Une réorganisation des équipes RH dans les académies a bien été lancée cette année, avec pour ambition d’accorder plus de soutien aux acteurs de terrain des établissements, mais cela ne suffira pas, car les moyens manquent encore dans la pratique. »
Si le ministère de l’Éducation nationale se dit attentif à la santé mentale des personnels, notamment depuis la pandémie de la Covid-19 et la tenue du
Grenelle de l’éducation, la situation reste préoccupante. Une réorganisation des équipes RH dans les académies
12 a bien été lancée cette année, avec pour ambition d’
accorder plus de soutien aux acteurs de terrain des établissements, mais cela ne suffira pas, car les moyens manquent encore dans la pratique. Outre les demandes des organisations syndicales liées à l’augmentation des effectifs et à l’amélioration des conditions de travail,
des associations plaident par exemple pour le recrutement de plus de psychologues13, afin de créer un point d’écoute dans chaque établissement.
Au-delà des temps d’observation et de concertation,
les personnels ont besoin d’actions concrètes et d’interlocuteurs de terrain pouvant à la fois agir en prévention, détecter les situations de fragilité et proposer des solutions.
Il faut une approche globale de l’environnement de travail dans les établissements scolaires pour réduire le stress auquel sont confrontés les enseignants et protéger leur santé physique et mentale.
Dans un contexte plus que jamais marqué par les craintes de violences physiques et verbales, renforcées par l’actualité récente et corroborées par le dernier
Baromètre du climat scolaire de L’ASL, les agents ont besoin d’acteurs de terrain sur lesquels compter. Qu’il s’agisse ou non de situations d’urgence, c’est l’un des rôles de L’ASL que de leur offrir toute l’écoute et les conseils dont ils ont besoin. Cela afin d’éviter que les tracas du quotidien, en s’accumulant, ne conduisent à de vraies situations de détresse.
Sources :
- Concertation sur l’attractivité et la revalorisation du métier enseignant, support de présentation de la réunion du 19 octobre 2022, education.gouv.fr
- Étude de climat scolaire dans le 1er degré, L'ASL
- Baromètre international de la santé et du bien-être du personnel de l'éducation, Réseau Éducation et Solidarité
- "Concours enseignants : à nouveau plusieurs milliers de postes non pourvus, qui confirment une crise structurelle», Le Monde, 6 juillet 2023
- Résultats des concours enseignants 2023, education.gouv.fr
- « Éducation nationale : le nombre de médecins du travail augmente, mais reste très faible », AEF info, dépêche n° 700613
- Panorama statistique des personnels de l'enseignement scolaire 2022-2023, education.gouv.fr
- La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de l'académie, Académie de Lyon
- Le RSST, premier outil d'alerte pour agir sur la sécurité au travail, SE-Unsa
- La prévention des risques professionnels, Académie de Lyon
- « Face à “la dégradation inquiétante de la santé mentale” à l’école, Pap Ndiaye annonce des mesures », Ouest France, 25 mai 2023
- « Le MENJ veut engager une “transformation” de l’organisation RH dans les académies », AEF info, dépêche n° 692030
- « Les professeurs attendent toujours leur visite médicale », Ouest France, 3 juillet 2022