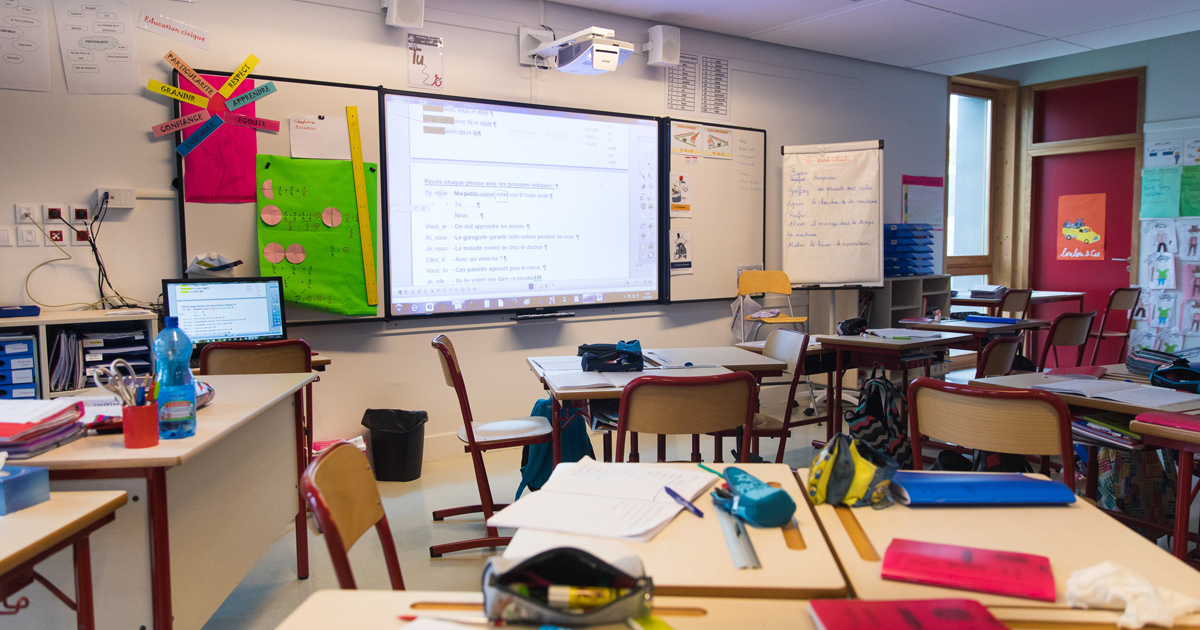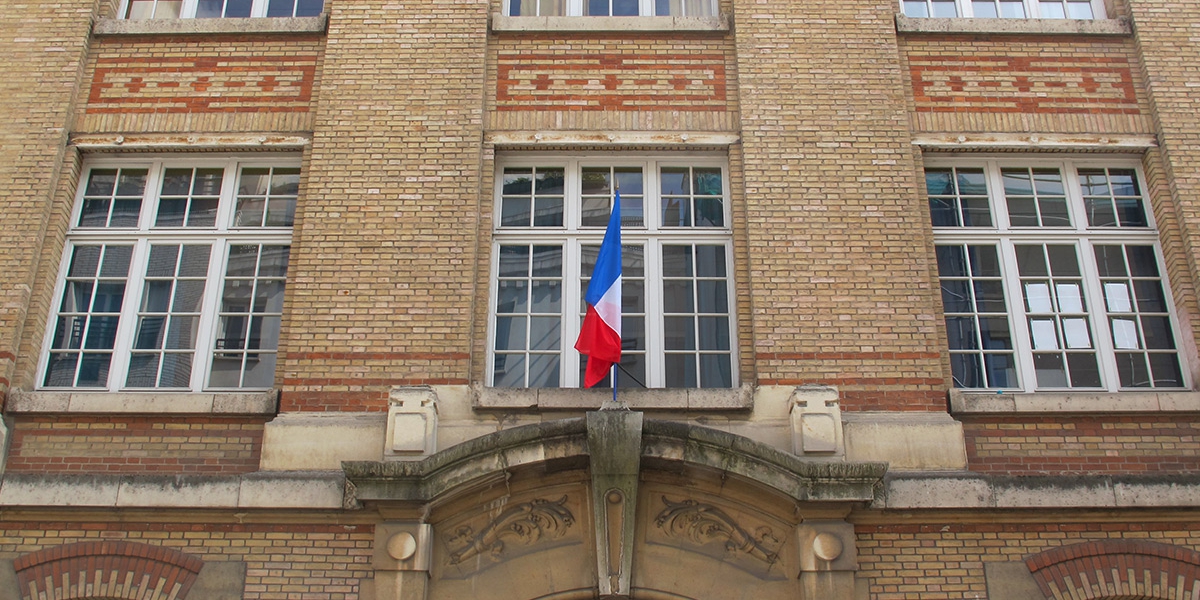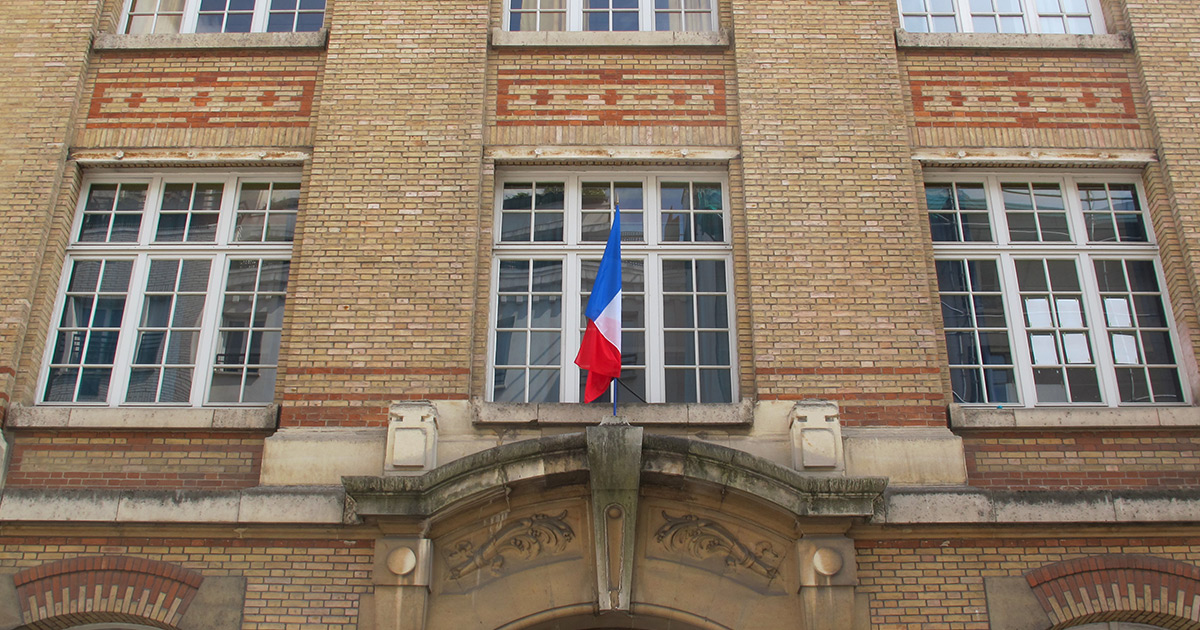L’objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales va se traduire par un meilleur accompagnement des élèves, une formation spécifique des personnels, mais aussi un renforcement des moyens.
[Valeurs républicaines]