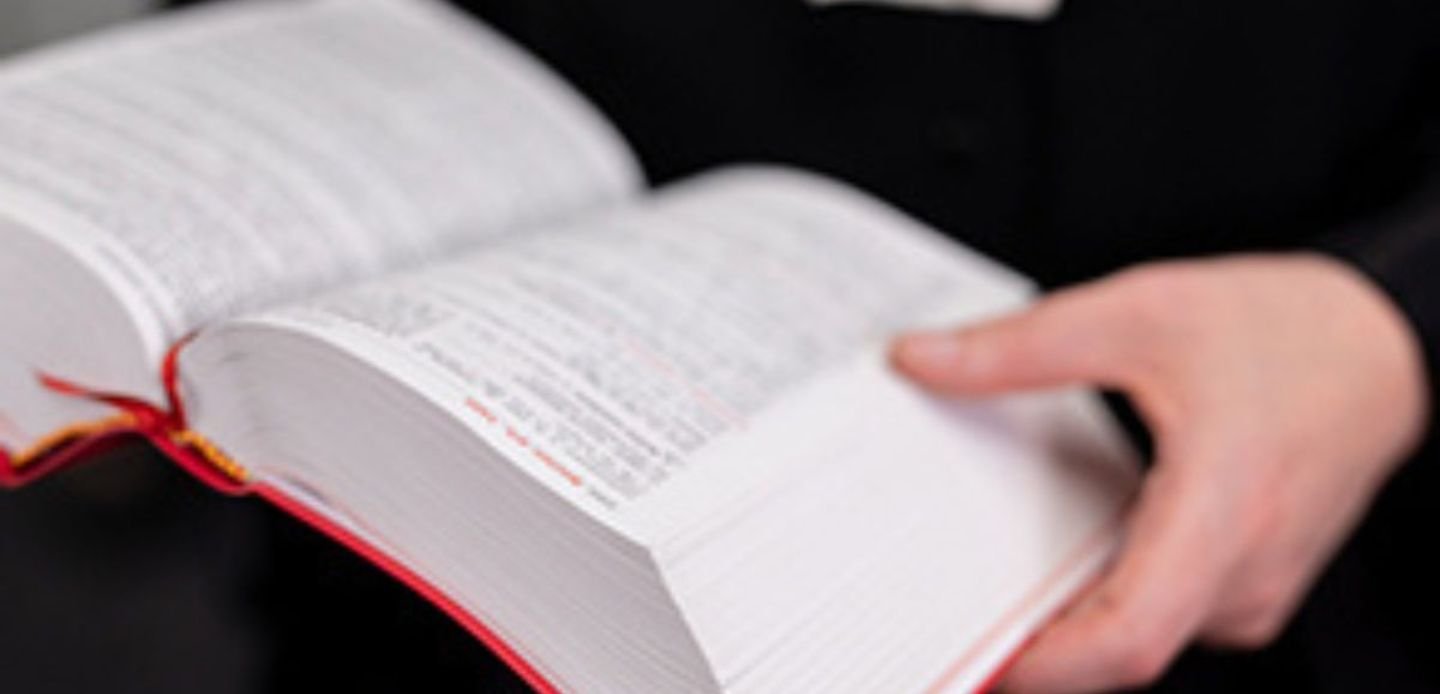
Adoptée en décembre 2021, la loi Rilhac a consacré le rôle spécifique des directrices et directeurs d’école, en leur reconnaissant une autorité fonctionnelle distincte de celle des autres enseignants. Les décrets d’application des 14 et 16 août 2023 précisent certains aspects opérationnels de cette fonction, notamment en matière de pilotage pédagogique et, de façon encadrée, pour la gestion de situations exceptionnelles mettant en jeu la sécurité ou la santé des élèves. Cependant, ces textes n’apportent pas de statut clair aux directeurs ni de moyens supplémentaires pour faire face à leurs nombreuses tâches administratives, malgré l’urgence mise en lumière par les difficultés du terrain. Maître Florence Lec, docteure en droit, avocate-conseil national de L’ASL, analyse la portée réelle de la Loi Rilhac et des décrets des 14 et 16 août 2023. Elle souligne les limites de ces dispositifs, à la lumière des défis concrets rencontrés par les directrices et directeurs d’école aujourd’hui.
La loi Rilhac et les décrets des 14 et 16 août 2023
“ La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021, dite « loi Rilhac », consacre la fonction de directrice ou directeur d’école primaire. ”
Cette loi a un double objectif :
La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021, dite « loi Rilhac », consacre la fonction de directrice ou directeur d’école primaire, matérialisant un mouvement de reconnaissance de leurs missions spécifiques dans le pilotage et le fonctionnement des écoles publiques.
- Reconnaître la spécificité du métier de directeur d’école, distincte de celle des enseignants de leur équipe.
- Clarifier les responsabilités et renforcer l’autorité fonctionnelle du directeur, sans pour autant créer un nouveau corps de personnels de direction.
Les décrets d’application du 14 août 2023 (n° 2023-777) et du 16 août 2023 (n° 2023-782) sont venus préciser les termes de la loi :
S’agissant du décret du 14 août 2023, il revient sur les missions, les conditions de nomination, les modalités d’exercice, et l’avancement accéléré des directeurs d’école.
Le décret du 16 août 2023, quant à lui, clarifie les modalités de gestion des situations de danger ou d’atteinte à la sécurité ou la santé au sein des écoles, étendant les pouvoirs du directeur en matière disciplinaire.
Les principaux apports sont les suivants :
1. Une autorité fonctionnelle renforcée
- C’est la principale innovation du décret du 14 août 2023 : Le directeur a désormais « autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire ». Cette autorité va donc au-delà des personnels de l’Éducation nationale et comprend un pouvoir d’autorité fonctionnelle sur les agents municipaux.
- « L’autorité » du directeur ou de la directrice d’école se traduit dans les missions qui leur sont confiées, notamment à l’égard de la collectivité de rattachement, puisqu’ils organisent désormais « le travail des agents communaux » et prennent « toutes dispositions (…) pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école durant le temps scolaire ». Ainsi, cette notion d’autorité s’inscrit dans la mission de coordination, de sécurité, de gestion de l’école, sans toutefois transposer le modèle de chef d’établissement du secondaire, ce qui n’est d’ailleurs pas le souhait d’une grande majorité de la profession.
2. Des missions de pilotage pédagogique
- Le directeur pilote le projet pédagogique, anime l’équipe enseignante, veille au suivi pédagogique et à la continuité des apprentissages.
- Il organise les conseils d’école et des maîtres, diffuse les instructions officielles, contribue à l’intégration des nouveaux membres et veille à la cohérence des pratiques pédagogiques.
3. L’évolution de carrière et les évaluations
- Le décret du 14 août 2023 met en place une bonification d’ancienneté de trois mois par an, spécifique aux directeurs, applicable sans rétroactivité à partir du 1er septembre 2023. Le décret prévoit en outre une évaluation par l’inspecteur de circonscription après trois ans d’exercice, puis tous les cinq ans.
- L’objectif affiché est d’accompagner le développement professionnel des directeurs et d’encourager la prise de fonction.
4. De nouvelles compétences disciplinaires
Le décret du 16 août 2023 a pour objet de « donner les moyens aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement d’apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement moral ».
Ainsi, « lorsque le maintien d’un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d’école après examen de la situation de l’élève par l’équipe éducative, le DASEN peut demander au maire de procéder à la radiation de l’élève de son école ».
Une procédure en plusieurs étapes
“ La loi Rilhac et ses décrets des 14 et 16 août 2023 ont marqué un tournant législatif pour la fonction de directeur d’école/directrice d’école, en lui donnant une visibilité nouvelle et des missions renforcées. ”
L’article R411-11-1 du Code de l’éducation nouvellement créé prévoit une procédure en plusieurs étapes :
Étape 1 : mise en place de mesures éducatives face au comportement inapproprié
Avec l’équipe éducative et « en associant les parents », la directrice ou le directeur d’école met en place « toute mesure éducative » de nature à faire cesser le comportement en cause ». Le directeur pourra, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève pendant une durée maximale de cinq jours, ce qui n’existait pas auparavant.
Cette procédure ne peut être déclenchée que dans des conditions strictement encadrées par le décret et tenant au comportement de l’élève et au risque qu’il fait peser :
- Un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école
Il n’est pas nécessaire que la sécurité ou la santé soit compromise, un simple « risque » suffit, mais il doit être « caractérisé », c’est-à-dire suffisamment grave. Cette notion est évidemment sujette à interprétation… Est-ce qu’une simple déclaration par l’enfant victime ou par ses parents suffit ? Est-ce qu’une déclaration de l’infirmière scolaire ou un certificat médical est nécessaire pour établir que le risque est caractérisé ? Le décret n’en dit rien…
Ce risque doit compromettre soit la sécurité, soit la santé ; il n’est donc pas nécessaire qu’elles se cumulent. S’agissant de la santé, cette notion, semble-t-il s’entend au sens large, santé physique et/ou santé mentale.
Par ailleurs, il est intéressant d’observer que la victime ne peut être qu’un élève de l’école. Ainsi, la mesure ne peut s’appliquer pour un risque pesant sur la santé ou la sécurité d’un personnel, qu’il soit enseignant, ATSEM, AESH, etc., alors que l’on sait que ces personnels se retrouvent de plus en plus en première ligne face à des élèves violents qui peuvent présenter des troubles psychiques et/ou psychiatriques…
- Un comportement intentionnel et répété
En droit pénal, le caractère intentionnel de l’infraction signifie que son auteur a eu conscience d’enfreindre la loi et a agi sciemment en vue de la réalisation de l’acte incriminé. S’agit-il de cela ici ? Le décret n’en dit rien. Est-ce que ce dispositif s’applique à des enfants souffrant de troubles psychiques ou neuropsychiques et qui seraient atteints, au moment de la commission des faits, d’une altération ou d’une abolition du discernement ? Le décret est ici encore silencieux. Il appartiendra à l’administration et à la jurisprudence de clarifier ce dispositif.
Ainsi, face à un comportement intentionnel et répété qui présente un risque caractérisé compromettant la santé ou la sécurité d’un élève, le directeur réunit l’équipe éducative et les parents de l’enfant auteur seront associés. Cette étape vise à dialoguer avec la famille et à trouver des solutions pour que le comportement cesse.
Ensuite, le directeur d’école prendra des mesures éducatives. À cet égard, il aurait été prudent, et dans un souci de pédagogie pour les parents, de lister dans le décret les mesures éducatives que le directeur d’école pourra mettre en place.
« Associer les parents », comme le prévoit le décret, n’implique pas que ces derniers donnent leur accord à la mesure, laquelle peut conduire à une suspension de l’élève, à titre conservatoire, de l’établissement. Cette suspension est encadrée et ne peut aller au-delà de cinq jours.
Étape 2 : la radiation de l’élève
En cas de réitération du comportement, le directeur d’école peut solliciter la radiation de l’élève.
Le décret prévoit que si le comportement de l’élève persiste, le DASEN, saisi par le directeur ou la directrice d’école, pourra demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune.
Dans l’hypothèse où la commune ne compterait qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne pourra intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
Dans sa nouvelle école, le dispositif prévoit que l’élève fera l’objet d’un suivi psychologique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année en cours.
Pendant la procédure de radiation, le directeur peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant le temps de la procédure.
Contrairement à la phase 1, on observe qu’aucune durée maximale de suspension n’est prévue. L’équipe éducative n’est pas associée, pas plus que les parents, dont l’accord n’est pas requis pour procéder au changement d’école de l’élève en cause.
On pourrait enfin s’interroger sur le suivi pédagogique et la continuité des apprentissages pour l’élève suspendu ; en effet, le décret n’en dit rien, ni dans l’étape 1, ni dans l’étape 2. Toutefois, celle-ci parait assurée à la lecture de l’article R411-15 du Code de l’éducation, qui prévoit que le directeur d’école « s’assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège ».
La loi Rilhac et ses décrets des 14 et 16 août 2023 ont marqué un tournant législatif pour la fonction de directrice et de directeur d’école, en lui donnant une visibilité nouvelle et des missions renforcées.
Toutefois, les attentes initiales en matière de moyens d’allégement des tâches et de clarification de l’autorité réelle sont loin d’être totalement satisfaites sur le terrain, faisant apparaitre ainsi un bilan contrasté pour ce nouvel arsenal juridique :
On regrette qu’il n’y ait pas de statut clairement établi, qu’aucune disposition ne traite du régime des décharges (qui n’a été que timidement toiletté en 2022) et, surtout, que les textes ne prévoient aucune aide pour les personnels dont on sait qu’ils subissent la gestion de lourdes tâches administratives ; ainsi près de six ans après le tragique suicide de Christine Renon, aucune aide significative n’est apportée au directeur d’école.
Par ailleurs, sur le terrain, le nouveau statut semble peu connu des principaux intéressés : ainsi, le rapport de l’Inspection générale de l’éducation remis à la ministre en juillet 2024 relevait que chez la plupart des directeurs d’écoles rencontrés, on observait une méconnaissance ou une perception vague du décret du 14 août 2023, qui redéfinit pourtant leurs missions de manière significative, notamment concernant la mission de pilotage pédagogique. Toutefois, il est également souligné dans le rapport que les directrices et directeurs d’école ont semblé davantage connaître le décret du 16 août 2023, et de souligner : « Il est symptomatique que les directeurs aient davantage à l’esprit le décret relatif au harcèlement scolaire plutôt que celui qui évoque leur rôle renforcé dans le pilotage pédagogique, car leur priorité absolue reste d’assurer la sécurité des élèves et des membres de leur équipe. »
Le législateur, tout comme le ministre de l’Éducation nationale, devront revoir de manière substantielle le cadre juridique aujourd’hui en place afin de répondre aux défis auxquels font face les directrices et directeurs d’école ; naturellement, L’ASL, aux côtés des personnels, sera force de proposition.



















