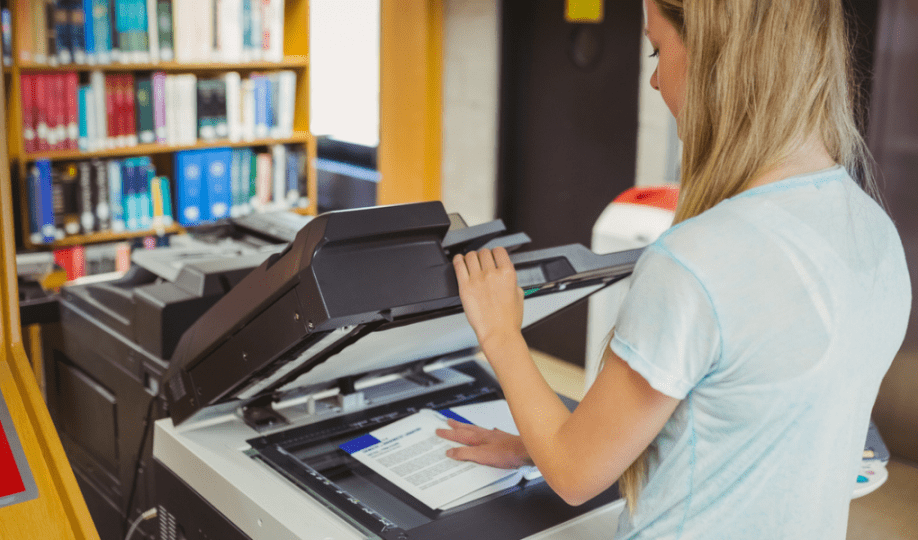Comment sensibiliser au droit à l’image des enfants ?
À une époque où le numérique tient une place prépondérante, la tentation est grande de photographier et filmer, puis de diffuser sur les réseaux sociaux, le blog ou le site de l’établissement, certains évènements comme un spectacle, une sortie, une …
Lire la suite